



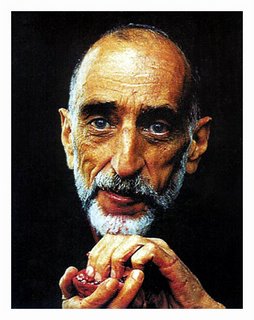
« Ainsi travestissons-nous de mille manières la mort, convertissant sa nécessité en accident. »
(Paul Ricœur, De l’interprétation, op. cit., p. 347.)
Nous passons à côté de la pensée de la mort. Nous pensons à la mort mais nous ne la pensons pas. Cette conversion ou subversion est celle de l’obsessionnel par excellence. Chez une telle personnalité, le trait est grossi, mais il n’agit guère différemment du sujet sain ; ce qui le distingue de l’homme « normal » est simplement l’excès de pensée qu’il dépense pour se protéger du réel, si par réel on comprend ce qui est et ne peut pas ne pas être, ce que nous avons souvent coutume de nommer nécessité, et qui est peut-être bien la seule nécessité dont nous puissions nous réclamer. L’obsessionnel ou le phobique est dispendieux : il pense trop. Penser trop signifie dans son cas penser plus que de raison, à savoir plus qu’il n’est utile eu égard aux circonstances dans lesquelles il se trouve : il élargit démesurément le champ de son action possible et de sa connaissance. Par exemple, lorsque cette dame n’ose pas prendre le train, de peur qu’il ne déraille ou bien que quelqu’un ne dépose une bombe dans un wagon, ou bien parce qu’elle a peur de se faire agresser durant son voyage, ou encore lorsqu’elle ne sait quelle place choisir dans le train, estimant qu’un destin est attaché à tous ses choix, même les plus infimes, elle pense au-delà de ses possibilités ; elle pense faux si penser vrai est penser proportionnellement à ce qu’il est « normal » de penser. La normalité de la pensée se mesure à l’extension et à la compréhension de celle-ci. Mais comment mesurer ? A partir de quel étalon ? Selon quelle échelle ?
Il est normal d’être prudent, il n’est pas normal d’extrapoler, d’imaginer des scénari abracadabrantesques. Le mot de prudence nous invite à définir ce que nous nommons normalité, et qui correspond à la voie moyenne qu’emprunte l’homme sage, et au chemin que tente de rattraper l’homme commun ou le sujet « sain ». Le moyen est le juste milieu entre deux excès possibles.
Pourtant, en y songeant sérieusement, les idées de la dame précédemment évoquée sont-elles aussi folles qu’il y paraît ? Tous les dangers qu’elle redoute à force de penser sont possibles ; il n’y a rien qui permette d’affirmer que rien de ce qu’elle a imaginé n’adviendra pas. Est-ce à dire pour autant que ses craintes sont fondées ? Non, car si la dame poussait jusqu’au bout ses raisonnements, elle ne pourrait plus sortir de chez elle, et même ne pourrait plus bouger à l’intérieur de sa maison, et elle pourrait même en venir à redouter que le danger pût venir d’elle-même. Vivre, c’est risquer sa vie et affirmer que le risque est plus avantageux à l’être vivant que l’absence de risque.
En effet, il convient de mettre en exergue une ambiguïté qui tient à la manière dont on conçoit la nécessité : la nécessité est la caractéristique que l’on attribue à un événement et on peut l’attribuer à un événement passé, présent ou futur. Or, il ne s’agit pas à chaque fois de la même nécessité. Celle qui concerne les faits passés et présents est une « nécessité » avérée de fait, tandis que celle que l’on conjugue au futur est une nécessité qui n’est pas prouvée, qui est simplement conjecturée, et qui est beaucoup plus troublante et difficile à penser que la précédente. De ce type de nécessité est ce que l’on appelle le destin ou la fatalité. En effet, dire de ce qui est ou a été que cet événement est nécessaire est une sorte de truisme. Puisque l’on ne peut ni changer le passé ni le présent, les faits qui appartiennent à l’un ou à l’autre, mais cette nécessité est une nécessité de discours, une nécessité après coup, et non une nécessité ontologique, qui appartienne en propre à l’essence des êtres ou événements qu’elle concerne. La nécessité de discours, ce que nous appelons ainsi, et qui ne concerne les faits qu’extérieurement et a posteriori est toujours conçue comme accidentelle, quoi qu’on en dise. Tout autre est la nécessité des choses à venir, la nécessité nécessairement nécessaire. Il y a bien trois sortes de nécessités à distinguer ici : trois niveaux qui s’entrecroisent dans notre représentation de la mort – mais également de tout événement significatif pour nous. La nécessité comme ordre métaphysique présidant à l’existence de tout ce qui existe et organisant les rapports des êtres et des choses au sein de l’univers, la nécessité logique inhérente à la pensée et au langage, à leur possibilité même, et la nécessité du fait présent ou passé, autre nom du réel. Toute la difficulté consiste à séparer ces trois manières de penser la nécessité et à ne point les confondre entre elles.
Considérer la mort comme une nécessité, qu’est-ce que cela signifie ? Et, au contraire, éviter de la penser comme telle, qu’est-ce que cela veut dire ?
La mort est un fait expérimentalement vérifiable. Mais il s’agit toujours de la mort des autres, une expérience par personne interposée et une « expérience métonymique ». Constater de visu la mort d’un être, contempler, toucher ou sentir un cadavre ne nous permet pas d’expérimenter la mort mais de simplement de la constater à titre de conséquence d’un processus biologique, physique. Ce n’est pas la mort à proprement parler que l’on constate mais l’absence de vie ; le médecin qui signe un certificat de décès ne fait que relever les preuves d’une cessation de l’activité vitale, il ne peut saisir l’essence de la mort en elle-même, il ne peut que la mettre en relation avec la vie, comme contraire de celle-ci. Ni plus ni moins. Or, la mort est un processus actif qui a partie liée avec la vie ; mort et vie sont un couple indissoluble, une paire, les deux plateaux d’une balance, la trame et la chaîne. Si l’une cesse, l’autre également. La mort n’existe donc que tant que la vie existe et pourtant elles ne se concernent pas réciproquement.
Logiquement, la mort n’est pas nécessaire : elle ne s’oppose à aucun principe logique qui empêcherait la pensée d’avancer ou le discours de se délier. Affirmer que « la mort n’est pas nécessaire » n’est pas une proposition illogique. En effet, rien ne vient heurter la logique formelle, ni même la logique appliquée aux faits. Dire que la mort est « probable », « certaine » convient aussi bien que de dire d’elle qu’elle est nécessaire. Proclamer qu’elle n’est pas nécessaire n’engendre aucune difficulté logique ou linguistique. Scientifiquement, la mort n’est pas envisagée sous son aspect nécessaire.
Rien non plus ne semble laisser penser que la mort soit une nécessité métaphysique. Non pas que l’homme récuse la nécessité de la mort en général, comme horizon ou ligne de fuite, mais il la récuse dans tous les cas particuliers où elle peut se présenter à lui.
Le philosophe n’est pas en reste puisqu’il joue sur différentes manières de concevoir la nécessité. La mort est pour la raison une nécessité intellectuelle qui n’est absolument pas vécue, qui ne peut être vécue, c’est à peine si on peut la penser en première personne. La question étant désormais de savoir si oui ou non on peut penser la mort autrement que sous la forme d’un évitement. Que signifierait penser la mort philosophiquement sans échappatoire ? On le pressent cette pensée authentique de la mort doit porter sur le caractère nécessaire de celle-ci, nécessité objective en même temps que subjective, nécessité subjectivement objective et objectivement subjective. La nécessité est un concept abstrait, elle est construite par l’intellect à partir de faits qui sont pensés en relation les uns avec les autres, et non pas perçue par les sens. La nécessité ne concerne jamais un fragment du réel en lui-même et pour lui-même et est toujours au minimum duelle. La nécessité est un lien logique qui établit une relation entre plusieurs fragments du réel ; cette relation est absolument construite, intellectuelle. La nécessité n’existe que dans ma pensée. Hume et, à sa suite, Kant ont parfaitement compris la nature de ce concept. S’il me paraît nécessaire que je sois malade aujourd’hui, c’est parce que je relie le fait d’être présentement mal en point à celui de n’avoir pas fait preuve de prudence ou de sagesse en m’exposant sans précautions au froid la veille. Si je juge qu’il est nécessaire que je meure un jour, c’est parce que je relie cet événement personnel à l’expérience que nous avons de la mort des autres, à la connaissance que nous avons acquise de la mort comme un fait naturel qui parachève chaque existence, humaine, animale, végétale. Si j’affirme qu’il est nécessaire qu’un triangle ait trois angles, je ne le puis et ne le dois qu’à la faveur d’une élémentaire connaissance des figures géométriques. La nécessité est donc une reconnaissance qui s’appuie sur la logique propre à tout discours et sur l’expérience que nous avons des choses, expérience concrète ou expérience de pensée sans preuve concrète ; la nécessité n’existe pas réellement, elle est simplement utile à la pensée, voire indispensable pour établir la vérité de certains faits, ou plus exactement leur véracité. La différence que nous faisons entre vérité et véracité tient à la part subjective de croyance inhérente à la seconde : la vérité n’a besoin de personne pour être, elle tient en quelque sorte toute seule et exerce la plus grande des tyrannies sur le sujet qui n’a pas d’autre choix que de reconnaître s’il use correctement de son entendement et s’il est de bonne foi, tandis que la véracité d’un fait ou d’une déclaration est le versant subjectif de la vérité, que lesdits fait ou déclaration soient objectivement vrais ou faux. Dans la véracité, ce qui est importe le plus est le crédit que nous accordons à ce qui est présenté à nos sens et/ou à notre intellect comme vrai, en dehors de toute considération objective de vérité – bien que le vrai demeure à titre d’exigence, ou comme arrière-pensée de la véracité, qui sans lui perdrait son sens. Pourquoi alors ne pas parler de vraisemblance ou de probabilité des choses ou du discours sur les choses ? Parce que la probabilité, comme la vraisemblance ou le caractère de vérité ne s’applique qu’à l’objet qu’ils qualifient, tandis que la véracité peut s’appliquer, par exemple, à un phénomène comme l’illusion, comme le mensonge ou même la fiction, dans la mesure où ils nous parlent, où ils nous disent quelque chose que l’on ressent, à bon droit ou non, comme vrai. Dans une représentation théâtrale, tout est faux mais tout est vérace. Ce qui est faux, au théâtre, c’est la stricte concordance entre les faits donnés à voir, à entendre, à comprendre et leur existence hors de la scène. Les acteurs ne sont pas ce qu’ils donnent voir, ils ne sont que représentatifs d’homme et de femmes qui n’existent pas concrètement – mais ils existent bel et bien à l’état d’idées, de modèles, abstraitement donc. L’acteur prête sa corporéité à ce qui en est dépourvu.
Toutefois, il s’avère que l’on oublie la nature exclusivement logique de la nécessité et qu’on substantialise ce concept. Le destin, la fatalité tragique, Dieu ne sont que des visages de la nécessité logique à laquelle on attribue une volonté, un entendement, un plan qu’elle met en œuvre. Cette contamination de l’univers par la pensée humaine, par la logique, par le principe même de toute pensée possible, par cette forme d’anthropomorphisme est ce qui permet de donner un sens à l’existence humaine.
« Nous insistons toujours sur le caractère occasionnel de la mort : accident, maladie, infection, profonde vieillesse, révélant ainsi nettement notre tendance à dépouiller la mort de tout caractère de nécessité, à en faire un événement purement accidentel. L’accumulation de cas de mort nous effraye. »
« Cette attitude à l’égard de la mort réagit cependant fortement sur notre vie. La vie s’appauvrit, elle perd en intérêt, dès l’instant où nous ne pouvons pas risquer ce qui en forme le suprême enjeu, c’est-à-dire la vie elle-même. Elle devient aussi vide, aussi creuse qu’un flirt dont on sait d’avance qu’il n’aboutira à rien à la différence d’un amour réel, alors que les deux partenaires sont tenus de toujours penser aux sérieuses conséquences du jeu dans lequel ils se trouvent engagés. Nos attaches affectives, l’insupportable intensité de notre chagrin nous détournent de la recherche de dangers pour nous-mêmes et nos proches. Nous reculons devant de nombreuses entreprises, dangereuses, mais indispensables, telles qu’essais d’aviation, expéditions dans des pays lointains, expériences sur des substances explosives, etc. Et ce qui nous retient, c’est la question que nous nous posons dans chacune de ces occasions : qui remplacera, en cas de malheur, le fils à la mère, l’époux à l’épouse, le père aux enfants ? La tendance à éliminer la mort du registre de la vie nous a encore imposé beaucoup d’autres renoncements et éliminations. Et, cependant, la devise hanséatique proclamait : Navigare necesse est, vivere non necesse ! Naviguer est une nécessité ; vive n’est pas une nécessité. Et nous sommes amenés tout naturellement à chercher dans le monde de la fiction, dans la littérature, au théâtre ce que nous sommes obligés de nous refuser dans la vie réelle.
Nous y trouvons encore des hommes qui savent mourir et s’entendent à faire mourir les autres. Là seulement se trouve remplie la condition à la faveur de laquelle nous pourrions nous réconcilier avec la mort. Cette réconciliation, en effet, ne serait possible que si nous réussissions à nous pénétrer de la conviction que, quelles que soient les vicissitudes de la vie, nous continuerons toujours à vivre, mais d’une vie qui sera à l’abri de toute atteinte. Il est, en effet, trop triste de savoir que la vie ressemble à un jeu d’échecs où une seule fausse démarche peut nous obliger à renoncer à la partie avec cette aggravation que, dans la vie, nous ne pouvons même pas compter sur une partie de revanche. Mais dans le domaine de la fiction nous trouvons cette multiplicité de vie dont nous avons besoin. Nous nous identifions avec un héros dans sa mort, et cependant nous lui survivons, tout prêts à mourir aussi inoffensivement une autre fois, avec un autre héros.»
Le risque donne peut-être sa saveur à la vie, la mort son poids à nos décisions et à nos actes ; il est possible que la fin de notre existence soit également sa fin, son but. »
Quelques chapitres...
Les roses du Pays d'Hiver
Retrouvez une nouvelle floraison des Roses de décembre ici-même.
Rechercher sur mon JIACO
Qui suis-je ?

- Holly Golightly
- Never Never Never Land, au plus près du Paradis, with Cary Grant, France
- Dilettante. Pirate à seize heures, bien que n'ayant pas le pied marin. En devenir de qui j'ose être. Docteur en philosophie de la Sorbonne. Amie de James Matthew Barrie et de Cary Grant. Traducteur littéraire. Parfois dramaturge et biographe. Créature qui écrit sans cesse. Je suis ce que j'écris. Je ne serai jamais moins que ce que mes rêves osent dire.
Almanach barrien
En librairie
Où Peter Pan rencontre son double féminin...


Oeuvre de Céline Lavail


Lettres
Voyages
Écosse
Kirriemuir
Angleterre
Londres
Haworth
Allemagne
Venise
New York
Liens personnels
Le site de référence de J.M. Barrie par Andrew Birkin (anglais)
Mon site consacré à J.M. Barrie (français ; en évolution permanente)
Site de la Société des amis de J.M.Barrie (français ; en construction)
Liens affiliés à ce JIACO
Blog Archive
- 2020 (1)
- 2019 (1)
- 2018 (4)
- 2017 (8)
- 2016 (1)
- 2015 (22)
- 2014 (15)
- 2013 (22)
- 2012 (34)
- 2011 (20)
- 2010 (34)
- 2009 (66)
- 2008 (74)
- 2007 (143)
-
2006
(447)
- décembre(21)
- novembre(19)
- octobre(20)
- septembre(21)
- août(33)
- juillet(23)
- juin(43)
- mai(44)
- avril(62)
- mars(50)
- février(51)
-
janvier(60)
- janv. 31(3)
- janv. 30(3)
- janv. 27(1)
- janv. 26(1)
- janv. 25(4)
- janv. 24(3)
- janv. 23(3)
- janv. 22(1)
- janv. 20(2)
- janv. 19(3)
- janv. 18(2)
- janv. 17(1)
- janv. 16(2)
- janv. 15(1)
- janv. 13(5)
- janv. 12(2)
- janv. 11(2)
- janv. 10(3)
- janv. 09(1)
- janv. 08(1)
- janv. 07(2)
- janv. 05(4)
- janv. 04(2)
- janv. 03(2)
- janv. 02(2)
- janv. 01(4)
- 2005 (217)
Archives
-
►
2018
(4)
- ► juillet 2018 (1)
- ► avril 2018 (1)
- ► février 2018 (1)
-
►
2017
(8)
- ► juillet 2017 (6)
- ► avril 2017 (1)
-
►
2015
(22)
- ► décembre 2015 (3)
- ► octobre 2015 (1)
- ► avril 2015 (1)
-
►
2014
(15)
- ► juillet 2014 (3)
- ► janvier 2014 (1)
-
►
2013
(22)
- ► novembre 2013 (1)
-
►
2012
(34)
- ► novembre 2012 (1)
- ► juillet 2012 (12)
- ► avril 2012 (1)
-
►
2011
(20)
- ► décembre 2011 (1)
- ► octobre 2011 (1)
- ► septembre 2011 (1)
- ► janvier 2011 (1)
-
►
2010
(34)
- ► novembre 2010 (1)
-
►
2009
(66)
- ► juillet 2009 (11)
- ► avril 2009 (8)
-
►
2008
(74)
- ► novembre 2008 (1)
- ► septembre 2008 (4)
- ► juillet 2008 (17)
- ► avril 2008 (11)
-
►
2007
(143)
- ► décembre 2007 (8)
- ► novembre 2007 (6)
- ► juillet 2007 (14)
- ► avril 2007 (18)
- ► février 2007 (16)
-
▼
2006
(447)
- ► décembre 2006 (21)
- ► novembre 2006 (19)
- ► octobre 2006 (20)
- ► septembre 2006 (21)
- ► juillet 2006 (23)
- ► avril 2006 (62)
- ▼ février 2006 (51)
- ► janvier 2006 (60)
-
►
2005
(217)
- ► décembre 2005 (62)
- ► novembre 2005 (98)
- ► octobre 2005 (49)



