La Mare au Diable
Vidéo envoyée par misshollygolightly








- A Cock and Bull Story
- La fille à la valise de Valerio Zurlini Parisiens ! Profitez ! Deux films de Zurlini sont remis à l'affiche : La fille à la valise


- L'argent de la vieille (1972) - Lo Scopone scientifico est typique de la comédie italienne : exubérance, bavardage, hystérie collective et privée, humanité. Un des meilleurs films de Comencini selon moi !



Pigeons
Vidéo envoyée par misshollygolightly
Venezia
Vidéo envoyée par misshollygolightly
Le Florian
Vidéo envoyée par misshollygolightly
Quitter venise
Vidéo envoyée par misshollygolightly



La chute originelle est celle du savoir qui corrompt tout ; aucune action pure n’existe en ce monde. La sincérité d’un cœur est indicible. Nous sommes les mercenaires d’une fausseté consentie depuis l’aube des temps. Nous nous soumettons à cette fatalité car nous ne pouvons la briser. L’innocence retrouvée est celle de l’instant d’inattention à soi. Jankélévitch est celui qui a le mieux parlé de cet infinitésimal. L’enfant est déjà talé car il sait aussi bien maniérer que l’adulte. Observez les petites filles qui s’entraînent à cette odieuse forme de séduction – celle-ci n’est pas tout à fait abjecte, car l’enfance possède une grâce accidentelle, et on lui pardonne. Mais cette grâce est davantage esthétique que morale, vous en conviendrez peut-être.
Le théâtre des marionnettes (1810) peut presque se lire comme un délectable essai phénoménologique ou bien comme une réflexion ajourée, de portée métaphysique. La mécanique de la conscience est exposée par la médiation de la poupée. Malgré l’extrême concision d’un texte qui ne dépasse pas quinze pages, il est indéniable que Kleist donne vie à une conception de l’existence humaine qui, si elle n’est pas originale, a le bon goût de s’exposer dans la finesse d’une métaphore parfaite. Il fait jouer devant nos yeux un mouvement et expose notre ressort. Il devient l’instrument de notre autoscopie. Il y a paradoxe. Comment dire de l’intérieur ce qui ne se montre que de l’extérieur ? Deleuze, je m’en rends compte à l’instant, écrivit ceci : « C’est que les éléments de son œuvre [celle de Kleist] sont le secret, la vitesse, l’affect. Et le secret n’est plus chez lui un contenu pris dans une forme d’intériorité, au contraire il devient forme, et s’identifie à la forme d’extériorité toujours hors d’elle-même. »
(Deleuze et Guattari, Mille plateaux)
Là où Bergson définissait à juste titre ce qui provoquait le rire comme la résultante du mécanique plaqué sur du vivant, Kleist n’agit pas différemment en invoquant un inverse, le vivant qui se superpose à la matière. Dans La double vie de Véronique de Krzysztof Kieslowski, le marionnettiste, Bruce Schwartz (marionnettiste dans la vie réelle), nous donne peut-être ce que Kant nous a toujours refusé : une intuition intellectuelle. Il est très remarquable de constater que cet homme de l’art ne cache pas ses mains dans des gants noirs, car nous finissons par ne plus voir ses mains. La magie du geste sublime rend aveugle au prosaïsme. Il est possible que Bergson ait eu connaissance du texte de Kleist, mais rien n’est sûr, car il donne un autre aperçu des rapports entre le vivant et le figé.
Lecteur de Kant qu’il comprend mal, Kleist s’imagine que ce dernier renonce à la connaissance humaine ; puis, il songe que la conscience nous prive du bonheur. Ce thème est celui, bien entendu, de la Genèse mais aussi du Paradis perdu de Milton. Kleist est persuadé que la raison est une malédiction. Mais la conscience de sa propre damnation ne permet-elle pas à un accent divin de s’élever, au sublime d’éclore sur le fumier de l’âme humaine ?
Cet opuscule s’inscrit dans un horizon rousseauiste idyllique. Le propos est simple : un danseur d’opéra prétend que les marionnettes possèdent plus de grâce que n’importe quel danseur car elles ne subissent pas cette malédiction qu’est l’affectation, autre nom d’une conscience trop consciente d’elle-même, qui ne fait plus porter le poids de son attention dans la précision du geste mais dans le regard intérieur ou dans celui du spectateur. La matière brute et les deux dieux seuls possèdent cette innocence gesticulatoire. C’est ainsi que l’on en revient à mon précédent billet consacré au jeu de rôle ou à la mauvaise fois sartrienne de la coquette. Que serait une conscience pure, qui ne se dédoublerait pas ? Poser la question est impertinence et déjà une faute.
« Chaque mouvement avait son centre de gravité ; il suffisait de le diriger, de l’intérieur de la figure ; les membres, qui n’étaient que des pendules, suivaient d’eux-mêmes, sans autre intervention, de manière mécanique.
Il ajouta que ce mouvement était fort simple ; chaque fois que le centre de gravité se déplaçait en ligne droite, les membres décrivaient des courbes (…) cette ligne était extrêmement mystérieuse car elle n’était rien d’autre que le chemin qui mène à l’âme du danseur ; et il doutait que le machiniste puisse la trouver autrement qu’en se plaçant au centre de gravité de la marionnette, ou en d’autres mots, en dansant. »
(Trad. Jacques Outin, Ed. Mille et une nuits)
Ce texte me paraît une image possible du créateur littéraire.
Un an après l’écriture de ce texte, Kleist se suicidera avec son aimée, Adolfine (rebaptisée Henriette) Vogel, qui était atteinte d’un cancer sans espoir de rémission. Les suicidés sont mes frères. Ils sont, pour certains d’entre eux, comme des adultes mort-nés, qui sont entrés dans notre monde par erreur. Trop tôt ou trop tard. Ils clopinent dans les interstices.
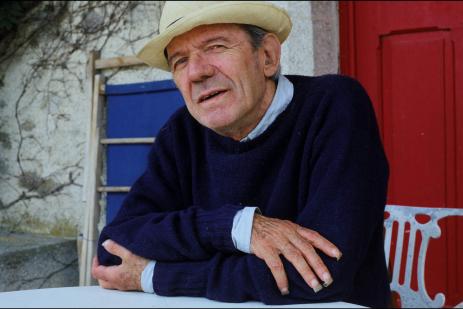
Dans la mauvaise foi, il n’y a pas mensonge cynique, ni préparation savante de concepts trompeurs. Mais l’acte premier de mauvaise foi est pour fuir ce qu’on ne peut pas fuir, pour fuir ce qu’on est. Or le projet même de fuite révèle à la mauvaise foi une intime désagrégation au sein de l’être, et c’est cette désagrégation qu’elle veut être. C’est que, à vrai dire, les deux attitudes immédiates que nous pouvons prendre en face de notre être sont conditionnées par la nature même de cet être et son rapport immédiat avec l’en-soi. La bonne foi cherche à fuir la désagrégation intime de mon être vers l’en-soi qu’elle devrait être et n’est point. La mauvaise foi cherche à fuir l’en-soi dans la désagrégation intime de mon être. Mais cette désagrégation même, elle la nie comme elle nie d’elle-même qu’elle soit mauvaise foi.
Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide, il vient vers les consommateurs d’un pas un peu trop vif, il s’incline avec un peu trop d’empressement, sa voix, ses yeux, expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client, enfin le voilà qui revient, en essayant d’imiter dans sa démarche la rigueur inflexible d’on ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu, qu’il rétablit perpétuellement d’un mouvement léger du bras et de la main. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s’applique à enchaîner ses mouvements comme s’ils étaient des mécanismes se commandant les uns les autres, sa mimique et sa voix même semblent des mécanismes ; il se donne la prestesse et la rapidité impitoyables des choses. Il joue, il s’amuse. Mais à quoi donc joue-t-il ? Il ne faut pas l’observer longtemps pour s’en rendre compte : il joue à être garçon de café.

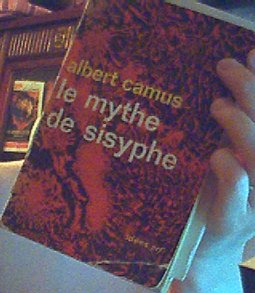
Quelques chapitres...
Les roses du Pays d'Hiver
Retrouvez une nouvelle floraison des Roses de décembre ici-même.
Rechercher sur mon JIACO
Qui suis-je ?

- Holly Golightly
- Never Never Never Land, au plus près du Paradis, with Cary Grant, France
- Dilettante. Pirate à seize heures, bien que n'ayant pas le pied marin. En devenir de qui j'ose être. Docteur en philosophie de la Sorbonne. Amie de James Matthew Barrie et de Cary Grant. Traducteur littéraire. Parfois dramaturge et biographe. Créature qui écrit sans cesse. Je suis ce que j'écris. Je ne serai jamais moins que ce que mes rêves osent dire.
Almanach barrien
En librairie
Où Peter Pan rencontre son double féminin...


Oeuvre de Céline Lavail


Lettres
Voyages
Écosse
Kirriemuir
Angleterre
Londres
Haworth
Allemagne
Venise
New York
Liens personnels
Le site de référence de J.M. Barrie par Andrew Birkin (anglais)
Mon site consacré à J.M. Barrie (français ; en évolution permanente)
Site de la Société des amis de J.M.Barrie (français ; en construction)
Liens affiliés à ce JIACO
Blog Archive
- 2020 (1)
- 2019 (1)
- 2018 (4)
- 2017 (8)
- 2016 (1)
- 2015 (22)
- 2014 (15)
- 2013 (22)
- 2012 (34)
- 2011 (20)
- 2010 (34)
- 2009 (66)
- 2008 (74)
- 2007 (143)
-
2006
(447)
- décembre(21)
- novembre(19)
- octobre(20)
- septembre(21)
- août(33)
- juillet(23)
- juin(43)
- mai(44)
- avril(62)
- mars(50)
- février(51)
-
janvier(60)
- janv. 31(3)
- janv. 30(3)
- janv. 27(1)
- janv. 26(1)
- janv. 25(4)
- janv. 24(3)
- janv. 23(3)
- janv. 22(1)
- janv. 20(2)
- janv. 19(3)
- janv. 18(2)
- janv. 17(1)
- janv. 16(2)
- janv. 15(1)
- janv. 13(5)
- janv. 12(2)
- janv. 11(2)
- janv. 10(3)
- janv. 09(1)
- janv. 08(1)
- janv. 07(2)
- janv. 05(4)
- janv. 04(2)
- janv. 03(2)
- janv. 02(2)
- janv. 01(4)
- 2005 (217)
Archives
-
►
2018
(4)
- ► juillet 2018 (1)
- ► avril 2018 (1)
- ► février 2018 (1)
-
►
2017
(8)
- ► juillet 2017 (6)
- ► avril 2017 (1)
-
►
2015
(22)
- ► décembre 2015 (3)
- ► octobre 2015 (1)
- ► avril 2015 (1)
-
►
2014
(15)
- ► juillet 2014 (3)
- ► janvier 2014 (1)
-
►
2013
(22)
- ► novembre 2013 (1)
-
►
2012
(34)
- ► novembre 2012 (1)
- ► juillet 2012 (12)
- ► avril 2012 (1)
-
►
2011
(20)
- ► décembre 2011 (1)
- ► octobre 2011 (1)
- ► septembre 2011 (1)
- ► janvier 2011 (1)
-
►
2010
(34)
- ► novembre 2010 (1)
-
►
2009
(66)
- ► juillet 2009 (11)
- ► avril 2009 (8)
-
►
2008
(74)
- ► novembre 2008 (1)
- ► septembre 2008 (4)
- ► juillet 2008 (17)
- ► avril 2008 (11)
-
►
2007
(143)
- ► décembre 2007 (8)
- ► novembre 2007 (6)
- ► juillet 2007 (14)
- ► avril 2007 (18)
- ► février 2007 (16)
-
▼
2006
(447)
- ► décembre 2006 (21)
- ► novembre 2006 (19)
- ► octobre 2006 (20)
- ► septembre 2006 (21)
- ► avril 2006 (62)
- ► février 2006 (51)
- ► janvier 2006 (60)
-
►
2005
(217)
- ► décembre 2005 (62)
- ► novembre 2005 (98)
- ► octobre 2005 (49)



