dimanche 13 août 2006
Le tour d’écrou (The Turn of the Screw), 1898
Henry James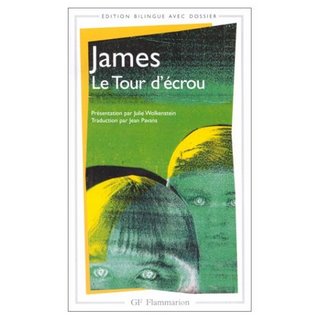 Ce roman aux dimensions d’une longue nouvelle est un classique du genre et, peut-être, la meilleure histoire de fantômes jamais écrite à ce jour, bien qu’il ne s’agisse pas exactement de revenants. Ou, si tel est le cas, pas dans le sens où vous seriez susceptibles d’entendre immédiatement ce dernier terme. Les reliques de nos souvenirs et de nos inconscients peuvent donner naissance à des revenants, sans même oser parler du retour du refoulé – expression que l’on peut mettre au pluriel…
Ce roman aux dimensions d’une longue nouvelle est un classique du genre et, peut-être, la meilleure histoire de fantômes jamais écrite à ce jour, bien qu’il ne s’agisse pas exactement de revenants. Ou, si tel est le cas, pas dans le sens où vous seriez susceptibles d’entendre immédiatement ce dernier terme. Les reliques de nos souvenirs et de nos inconscients peuvent donner naissance à des revenants, sans même oser parler du retour du refoulé – expression que l’on peut mettre au pluriel…
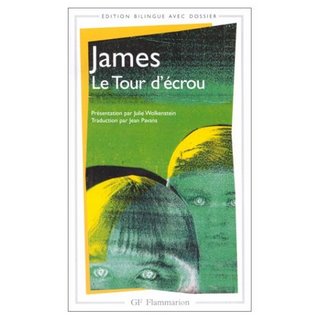 Ce roman aux dimensions d’une longue nouvelle est un classique du genre et, peut-être, la meilleure histoire de fantômes jamais écrite à ce jour, bien qu’il ne s’agisse pas exactement de revenants. Ou, si tel est le cas, pas dans le sens où vous seriez susceptibles d’entendre immédiatement ce dernier terme. Les reliques de nos souvenirs et de nos inconscients peuvent donner naissance à des revenants, sans même oser parler du retour du refoulé – expression que l’on peut mettre au pluriel…
Ce roman aux dimensions d’une longue nouvelle est un classique du genre et, peut-être, la meilleure histoire de fantômes jamais écrite à ce jour, bien qu’il ne s’agisse pas exactement de revenants. Ou, si tel est le cas, pas dans le sens où vous seriez susceptibles d’entendre immédiatement ce dernier terme. Les reliques de nos souvenirs et de nos inconscients peuvent donner naissance à des revenants, sans même oser parler du retour du refoulé – expression que l’on peut mettre au pluriel…Amenabar s’en est inspiré pour son film Les autres,
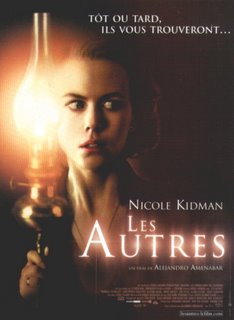
bien que la filiation soit moins évidente que celle qui s’affirme dans le film de Clayton, œuvre plus littérale.
Le point commun entre Amenabar et James est l’étrangeté dissolue qui remue l’esprit des divers personnages. La grande réussite du cinéaste repose sur sa capacité à prendre à parti le spectateur et à l’obliger à un retournement sur lui-même à la fin de son film. De gré ou de force, nous participons au déroulement de l’histoire car nous sommes contraints d’y apposer fermement notre conscience, comme une loupe sur des mots écrits trop petit pour être déchiffrés de loin par les myopes que nous sommes tous. En ceci, Amenabar est fidèle aux exigences jamesiennes.
L’histoire se glisse dans ce que Henry James appelle « la chambre intérieure de [notre] épouvante. » Il existe, bien sûr, en chacun de nous, un compartiment où s’ébroue la peur, escortée des petites peurs fondatrices et destructrices de l’enfance, qui commencent avec celles du loup et des monstres qui se nourrissent de la nuit et des ombres. Voisine également en cet endroit souterrain la grande peur, celle qui danse la java dans notre crâne, lorsque l’on pense à la dame en noir. Il n’est pas si étonnant que, par contraste, les fantômes soient souvent représentés par le blanc. Sûrement une mesure d’apaisement, bien que le blanc désigne en divers endroits la mort. Ce qui est visible ne peut nuire autant que ce qui est celé à la vue, car il est un principe certain que l’on ne peut jamais prouver l’inexistence de quelque chose. Le (dernier) tour d'écrou n'est qu'une expression, parfaitement choisie, pour désigner ce qui visse notre angoisse au plus profond de notre esprit. Il suffit d'un petit rien pour que le doute oscille durablement vers la certitude déplaisante que nous sommes pris au piège. Il n'est pas sans importance que l'expression se trouve sous la plume de la gouvernante... Pourtant, n'est-ce pas une manière déguisée de la part de James afin de nous signifier notre perte ?
Ici, point de fantômes enrubannés dans des draps blancs. Il s’agit d’apparitions. Ce qui apparaît doit être perçu. Or, la perversité de cette histoire est de renvoyer la perception à la subjectivité des divers protagonistes. Puis, dans un dernier acte de sadisme littéraire, à celle du lecteur, qui est contraint d’inventer le fin mot de l’histoire. Si, comme le prétendait son frère, le grand William, neurasthénique à l'image de sa sœur Alice, trop peu connu en France, « Chacun est limité par ce qu’il peut imaginer. », on comprendra que Le tour d’écrou sera un émulsif différent pour chaque complexion. Je suis assez troublée par la concordance qui existe dans les écrits des deux frères, bien que l’un ait choisi la voie du roman et l’autre celle, plus aride, de la réflexion philosophique et psychologique pure. Chez les deux hommes, le flux de la conscience emporte dans ses flots jusqu’au moindre résidu de nos pensées, y compris les moins avouables.
On peut lire au-delà d’une histoire de fantômes, un récit plus complexe : celui des projections malsaines d’une gouvernante sur des enfants, peut-être (certainement !) pervertis. Mais rien n’est absolument certain sinon que l’enfance est le terreau des plantes vénéneuses. Tous les gosses sont des peaux de vache. On y lira aussi une métaphore du psychisme humain. L’œuvre est aussi riche que la compréhension éventuelle du lecteur l’autorise.
Henry James est un immense auteur. Proust fait figure de piètre phénoménologue à côté de lui ; la prose de James est encore plus exigeante que celle du dandy souffreteux susnommé, parce que plus sincère et gonflée d’une puissance inépuisable et inexplicable. Il exige beaucoup de ses lecteurs mais, en retour, il offre le centuple de votre don. Lire ne devrait jamais être un acte qui s’expose à la légère. Henry James n’a jamais galvaudé cet acte suprême qui, à mes yeux, a tout de la prière bien qu’elle s’adresse à un dieu invisible. Dans ce court roman, James ne donne pas la pleine mesure de son art, qui atteint sa perfection, selon moi, dans des romans tel que Les ailes de la colombe. Pourtant, la concision du propos et la gerbe d’interprétations provoquées prouvent la force de l’écrivain.
David Lodge, dans son sublime L’auteur ! L’auteur !,  retrace la vie de Henry James. Rien de comparable, bien entendu, avec l’immense biographie de Leon Edel,
retrace la vie de Henry James. Rien de comparable, bien entendu, avec l’immense biographie de Leon Edel,  mais Lodge fait preuve d'une admirable compréhension. Rien de tel qu'un écrivain pour en comprendre un autre. On retrouve une filiation avec son précédent roman, Pensées secrètes,
mais Lodge fait preuve d'une admirable compréhension. Rien de tel qu'un écrivain pour en comprendre un autre. On retrouve une filiation avec son précédent roman, Pensées secrètes, qui était, somme toute, un roman éminemment jamesien, puisqu’il "s’attaquait" à l’objet adulé du grand romancier : la pensée intime, la pensée des autres, la sienne, les entrecroisements de pensées... et les expériences sur la pensée ! On y rencontre, entre autres, Sylvia Du Maurier, la dame des pensées de Barrie, son père George, grand ami de James et, si l'on pense très fort à lui, Barrie lui-même !
qui était, somme toute, un roman éminemment jamesien, puisqu’il "s’attaquait" à l’objet adulé du grand romancier : la pensée intime, la pensée des autres, la sienne, les entrecroisements de pensées... et les expériences sur la pensée ! On y rencontre, entre autres, Sylvia Du Maurier, la dame des pensées de Barrie, son père George, grand ami de James et, si l'on pense très fort à lui, Barrie lui-même !
Bonheur de lire deux grands romanciers, qui ne sacrifient rien à l’intelligence mais n’en font pas pour autant, du moins explicitement, le sujet de leurs livres. La chair et le squelette, l’histoire et la réflexion. Trop souvent, les romanciers sacrifient à l’un ou l’autre pan de l’alternative, quand il ne faudrait jamais élire l’un ou l’autre. Il n’y a peut-être qu’un grand style qui soit capable d’unir ces deux exigences de l’art romanesque.
Catégories :
Libellés :cinéma,Henry James
Quelques chapitres...
Les roses du Pays d'Hiver
Retrouvez une nouvelle floraison des Roses de décembre ici-même.
Rechercher sur mon JIACO
Qui suis-je ?

- Holly Golightly
- Never Never Never Land, au plus près du Paradis, with Cary Grant, France
- Dilettante. Pirate à seize heures, bien que n'ayant pas le pied marin. En devenir de qui j'ose être. Docteur en philosophie de la Sorbonne. Amie de James Matthew Barrie et de Cary Grant. Traducteur littéraire. Parfois dramaturge et biographe. Créature qui écrit sans cesse. Je suis ce que j'écris. Je ne serai jamais moins que ce que mes rêves osent dire.
Almanach barrien
Rendez-vous sur cette page.
En librairie
Où Peter Pan rencontre son double féminin...


Oeuvre de Céline Lavail


Lettres
Voyages
Écosse
Kirriemuir
Angleterre
Londres
Haworth
Allemagne
Venise
New York
Liens personnels
Le site de référence de J.M. Barrie par Andrew Birkin (anglais)
Mon site consacré à J.M. Barrie (français ; en évolution permanente)
Site de la Société des amis de J.M.Barrie (français ; en construction)
Liens affiliés à ce JIACO
"Une fée est cachée en tout ce que tu vois." (Victor Hugo)
Blog Archive
- 2020 (1)
- 2019 (1)
- 2018 (4)
- 2017 (8)
- 2016 (1)
- 2015 (22)
- 2014 (15)
- 2013 (22)
- 2012 (34)
- 2011 (20)
- 2010 (34)
- 2009 (66)
- 2008 (74)
- 2007 (143)
-
2006
(447)
- décembre(21)
- novembre(19)
- octobre(20)
- septembre(21)
- août(33)
- juillet(23)
- juin(43)
- mai(44)
- avril(62)
- mars(50)
- février(51)
-
janvier(60)
- janv. 31(3)
- janv. 30(3)
- janv. 27(1)
- janv. 26(1)
- janv. 25(4)
- janv. 24(3)
- janv. 23(3)
- janv. 22(1)
- janv. 20(2)
- janv. 19(3)
- janv. 18(2)
- janv. 17(1)
- janv. 16(2)
- janv. 15(1)
- janv. 13(5)
- janv. 12(2)
- janv. 11(2)
- janv. 10(3)
- janv. 09(1)
- janv. 08(1)
- janv. 07(2)
- janv. 05(4)
- janv. 04(2)
- janv. 03(2)
- janv. 02(2)
- janv. 01(4)
- 2005 (217)
Archives
-
►
2018
(4)
- ► juillet 2018 (1)
- ► avril 2018 (1)
- ► février 2018 (1)
-
►
2017
(8)
- ► juillet 2017 (6)
- ► avril 2017 (1)
-
►
2015
(22)
- ► décembre 2015 (3)
- ► octobre 2015 (1)
- ► avril 2015 (1)
-
►
2014
(15)
- ► juillet 2014 (3)
- ► janvier 2014 (1)
-
►
2013
(22)
- ► novembre 2013 (1)
-
►
2012
(34)
- ► novembre 2012 (1)
- ► juillet 2012 (12)
- ► avril 2012 (1)
-
►
2011
(20)
- ► décembre 2011 (1)
- ► octobre 2011 (1)
- ► septembre 2011 (1)
- ► janvier 2011 (1)
-
►
2010
(34)
- ► novembre 2010 (1)
-
►
2009
(66)
- ► juillet 2009 (11)
- ► avril 2009 (8)
-
►
2008
(74)
- ► novembre 2008 (1)
- ► septembre 2008 (4)
- ► juillet 2008 (17)
- ► avril 2008 (11)
-
►
2007
(143)
- ► décembre 2007 (8)
- ► novembre 2007 (6)
- ► juillet 2007 (14)
- ► avril 2007 (18)
- ► février 2007 (16)
-
▼
2006
(447)
- ► décembre 2006 (21)
- ► novembre 2006 (19)
- ► octobre 2006 (20)
- ► septembre 2006 (21)
- ► juillet 2006 (23)
- ► avril 2006 (62)
- ► février 2006 (51)
- ► janvier 2006 (60)
-
►
2005
(217)
- ► décembre 2005 (62)
- ► novembre 2005 (98)
- ► octobre 2005 (49)



