J’étais le seul survivant de l’infortunée Anna Pink. Si épuisé étais-je qu’ils durent me porter jusqu’à leur cabane, et grande fut ma gratitude quand j’ouvris les yeux dans cet édifice romantique, au lieu de me retrouver dans la cabine de Davy Jones.
un film exigeant, poétique et humain, aux côtés de Peter Handke en ce qui concerne le scénario. J'ai toujours beaucoup aimé l'idée que je me fais depuis toujours, dans mon for intérieur, des anges. Je ne crois pas plus à ces êtres qu'aux fées, mais je fais semblant ; et faire semblant est aussi bien que réellement le faire ou le vivre. Je plagie quelque peu une déclaration de mon bien-aimé Barrie mais je ne trouve pas de meilleure façon d'exprimer ce vécu.
Wim Wenders a mis en images ma conception imaginaire des anges qui est tangence, murmure et fugue. Un ange tombe amoureux et pour prix de cette chute devient mortel. N'en sommes-nous pas tous arrivés à ce point ? Les plus chanceux d'entre nous, en tout cas.
Il y a quelques mois, j'avais découvert en salle son dernier film, Don't come knocking. Je pensais en parler ici même et puis je me suis retrouvée dans un maelström. Le temps est une denrée rare. Tout à coup je pense à lui, par association d'idées, et j'éprouve le besoin de jeter ces quelques lignes à l'eau, dans cette petite bouteille (d'encre et non pas de whisky) qu'est mon devenue mon JIACO. J'ai retrouvé, comme dans chacun de ses films, une sensation d'étrangeté qui surpique l'exposition de faits plutôt réalistes. Mélodie triste et douce. Tout pour plaire à une mélancHollyque.
La vie n'est pas une maladie ni un poison. La vie ressemble plutôt au sac à main d'une femme : un n'importe quoi où se frôlent les univers les plus hétéroclites. La beauté surgit du commun, du chaos et du hasard. C'est la récompense d'une vanité audacieuse au coeur de nos histoires personnelles.
Un acteur un peu raté, déglingué comme une guitare dont toutes les cordes serait cassées, s'enfuit d'un tournage et part à la recherche de son passé. Autrefois, il fut célèbre. Il n'est plus qu'un acteur de seconde main. Il s'en moque. Il a dépassé depuis longtemps cette ligne de fuite. Il va revoir sa mère qu'il a abandonnée hier, il y a dix ou vingts ans. Il est poursuivi par un type qui veut le contraindre à regagner le tournage du film.
Sur sa route, qui n'a pas de but réel, il retrouvera un ancien amour de dix secondes mais la partition est déchirée. Il a aimé avec la rapidité et la dévinvolture d'un alcoolique qui enfile son énième verre. Deux enfants, trop grands pour l'être encore vraiment, qui ne se connaissent pas, qui ignorent tout de leur père vont le croiser. Le ballet est mal chorégraphié. L'un (Sarah Polley, fragile et douce, dont j'ai fait la connaissance dans l'excellent film d'Isabel Coixet, Ma vie sans moi) le devine et est prête à l'aimer, car elle sait tout de la perte - elle porte sa mère sous son bras dans une urne ; l'autre lui en veut à bon droit. Ils se retrouvent dans le no man's land de leur mémoire. Et puis... Et puis...
Ce film m'évoque Honky-Tonk Man d'Eastwood : une tendresse identique veine ce long métrage sinueux. Mais Wim Wenders est moins désespéré que Clint. Mais, paradoxalement, peut-être plus pessimiste, car il ne fait pas de cette histoire un drame ou une tragédie (le malheur est noble) mais l'écrit et la filme comme une banalité de plus dans l'existence de ces êtres.
Bande annonce ici.

Mais la vie d'un homme n'a pas plus d'importance pour l'univers que celle d'une huître. Et quand bien même elle serait d'une si grande importance, l'ordre de la nature l'a effectivement soumise à la prudence de l'homme, et nous oblige, constamment, à nous déterminer à son sujet.Essai sur le suicide
- Une petite encyclopédie holmésienne :
- Ce que mangeait Jane Austen et ce que savait Charles Dickens :

- Un guide londonien écrit par le fils de Charles Dickens.
- Et un livre qui manque à ma collection : George Meredith: A Tribute par J. M. Barrie...

« (…) il n’y a pas de grand homme sur terre, hormis celui qui part à la conquête de lui-même. Et, dans certains hommes, la part maudite - qui est en chacun de nous -, est si forte que la combattre et malgré tout être vaincu n’est pas tout à fait un échec. Il est fou d’exiger une complète réussite de la part de ceux que nous voulons aimer. Nous devrions les rejoindre au moment où ils s’élèvent au-dessus d’eux-mêmes, pendant un instant, et faire preuve de compassion quand ils retombent. Dans les premiers temps, les jeunes amoureux pensent que l’autre est parfait, mais un amant plus noble vient quand ils découvrent les faiblesses de l’autre, et cet amour plus grand est tellement plus attractif qu’il rend vain tous les pleurs bien qu’il les flagelle en leur for intérieur. Ainsi, ils apprennent les limites de l’humanité, et cette part maudite qui est en moi n’est pas semblable à celle qui est en vous, mais nous en possédons tous une, et de là vient la pitié que nous éprouvons pour ceux qui sont marqués par cette tare, et naît alors le désir de s’aider les uns les autres, car la connaissance est compassion, et la compassion est amour. Comprendre ceci fait du Fils de Dieu un homme. » (Tommy et Grizel)
« Les contes de fées sont partout et de tous les jours ; nous sommes tous des princes et des princesses déguisés, ou des ogres, ou des nains malfaisants. Toutes ces histoires sont celles de la nature humaine, qui ne semble pas changer beaucoup en mille ans, et nous ne nous lassons jamais des fées parce qu’elles lui sont fidèles. »
Lady Anne Isabella Thackeray Ritchie (la fille aînée de Willliam Makepeace)
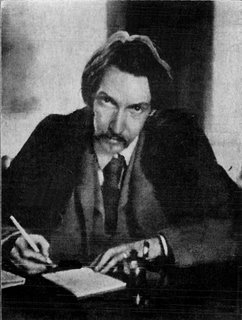
Vailima, décembre 1892
Cher J.M. Barrie,
Bien à vous,
Robert Louis Stevenson
Le 5 décembre 1892,
R.L.S.
http://www.marcel-schwob.org/
http://www.larevuedesressources.org/article.php3?id_article=13
- Première lettre :
Cher Monsieur Barrie,
Bien à vous,
Avec mon sincère intérêt quant à votre carrière,
Robert Louis Stevenson
Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés, car Stevenson est mort avant.
Quelques chapitres...
Les roses du Pays d'Hiver
Retrouvez une nouvelle floraison des Roses de décembre ici-même.
Rechercher sur mon JIACO
Qui suis-je ?

- Holly Golightly
- Never Never Never Land, au plus près du Paradis, with Cary Grant, France
- Dilettante. Pirate à seize heures, bien que n'ayant pas le pied marin. En devenir de qui j'ose être. Docteur en philosophie de la Sorbonne. Amie de James Matthew Barrie et de Cary Grant. Traducteur littéraire. Parfois dramaturge et biographe. Créature qui écrit sans cesse. Je suis ce que j'écris. Je ne serai jamais moins que ce que mes rêves osent dire.
Almanach barrien
En librairie
Où Peter Pan rencontre son double féminin...


Oeuvre de Céline Lavail


Lettres
Voyages
Écosse
Kirriemuir
Angleterre
Londres
Haworth
Allemagne
Venise
New York
Liens personnels
Le site de référence de J.M. Barrie par Andrew Birkin (anglais)
Mon site consacré à J.M. Barrie (français ; en évolution permanente)
Site de la Société des amis de J.M.Barrie (français ; en construction)
Liens affiliés à ce JIACO
Blog Archive
- 2020 (1)
- 2019 (1)
- 2018 (4)
- 2017 (8)
- 2016 (1)
- 2015 (22)
- 2014 (15)
- 2013 (22)
- 2012 (34)
- 2011 (20)
- 2010 (34)
- 2009 (66)
- 2008 (74)
- 2007 (143)
-
2006
(447)
- décembre(21)
- novembre(19)
- octobre(20)
- septembre(21)
- août(33)
- juillet(23)
- juin(43)
- mai(44)
- avril(62)
- mars(50)
- février(51)
-
janvier(60)
- janv. 31(3)
- janv. 30(3)
- janv. 27(1)
- janv. 26(1)
- janv. 25(4)
- janv. 24(3)
- janv. 23(3)
- janv. 22(1)
- janv. 20(2)
- janv. 19(3)
- janv. 18(2)
- janv. 17(1)
- janv. 16(2)
- janv. 15(1)
- janv. 13(5)
- janv. 12(2)
- janv. 11(2)
- janv. 10(3)
- janv. 09(1)
- janv. 08(1)
- janv. 07(2)
- janv. 05(4)
- janv. 04(2)
- janv. 03(2)
- janv. 02(2)
- janv. 01(4)
- 2005 (217)
Archives
-
►
2018
(4)
- ► juillet 2018 (1)
- ► avril 2018 (1)
- ► février 2018 (1)
-
►
2017
(8)
- ► juillet 2017 (6)
- ► avril 2017 (1)
-
►
2015
(22)
- ► décembre 2015 (3)
- ► octobre 2015 (1)
- ► avril 2015 (1)
-
►
2014
(15)
- ► juillet 2014 (3)
- ► janvier 2014 (1)
-
►
2013
(22)
- ► novembre 2013 (1)
-
►
2012
(34)
- ► novembre 2012 (1)
- ► juillet 2012 (12)
- ► avril 2012 (1)
-
►
2011
(20)
- ► décembre 2011 (1)
- ► octobre 2011 (1)
- ► septembre 2011 (1)
- ► janvier 2011 (1)
-
►
2010
(34)
- ► novembre 2010 (1)
-
►
2009
(66)
- ► juillet 2009 (11)
- ► avril 2009 (8)
-
►
2008
(74)
- ► novembre 2008 (1)
- ► septembre 2008 (4)
- ► juillet 2008 (17)
- ► avril 2008 (11)
-
►
2007
(143)
- ► décembre 2007 (8)
- ► novembre 2007 (6)
- ► juillet 2007 (14)
- ► avril 2007 (18)
- ► février 2007 (16)
-
►
2006
(447)
- ► décembre 2006 (21)
- ► novembre 2006 (19)
- ► octobre 2006 (20)
- ► septembre 2006 (21)
- ► juillet 2006 (23)
- ► avril 2006 (62)
- ► février 2006 (51)
- ► janvier 2006 (60)
-
►
2005
(217)
- ► décembre 2005 (62)
- ► novembre 2005 (98)
- ► octobre 2005 (49)



