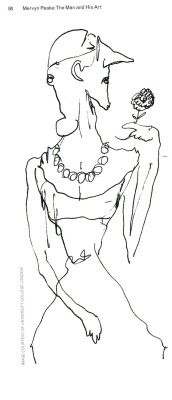C'était un aventurier de l'imaginaire, qui n'avait peur de rien et qui partait à la conquête de lui-même dans des univers obscurs et magnifiques, dont l'absurdité ou la bizarrerie vous paraissent, à la lecture, très logiques et naturels. Et puis Fuchsia, c'est moi. Et je sais aussi que je ne suis pas la seule à le penser.
Ici Mervyn et sa femme Maeve,
l'auteur d'un très beau livre de souvenirs, A World Away, que j'ai eu le plaisir et la chance de lire. Je ne peux que le recommander à tous ceux qui aiment Mervyn Peake.
Une blanche-Neige qui me plaît beaucoup avec son petit air hautain :
Lily a écrit un billet enthousiaste sur le premier volume de la trilogie.
Catégorie :
Barrie
 bien que je ne puisse juger que sur photographie !) qui donne vie à Moira Loney, l’héroïne si adorable de la pièce. Moira est l’un des prénoms de Wendy, l’autre étant Angela – elle est en quelque sorte une anticipation de cette petite mère - et cela fait, très évidemment, référence au destin, aux Parques ou Moires bien connues. Je vous renvoie à mon site en construction pour glaner photos et détails. Je devrais dès cette semaine me remettre à faire des mises à jour.
bien que je ne puisse juger que sur photographie !) qui donne vie à Moira Loney, l’héroïne si adorable de la pièce. Moira est l’un des prénoms de Wendy, l’autre étant Angela – elle est en quelque sorte une anticipation de cette petite mère - et cela fait, très évidemment, référence au destin, aux Parques ou Moires bien connues. Je vous renvoie à mon site en construction pour glaner photos et détails. Je devrais dès cette semaine me remettre à faire des mises à jour.
 Petit extrait de cette pièce qui fera partie du Volume Barrie à paraître en 2008. Il s'agit d'un fragment de l'acte I. Pardon pour la mise en page, qui n’est pas conforme aux us et coutumes de l’Imprimerie quant à la présentation d’une pièce, mais les « copier-coller » dans Blogger sont décidément trop capricieux et je n’ai pas le courage de reproduire les italiques et autres académismes requis.
Petit extrait de cette pièce qui fera partie du Volume Barrie à paraître en 2008. Il s'agit d'un fragment de l'acte I. Pardon pour la mise en page, qui n’est pas conforme aux us et coutumes de l’Imprimerie quant à la présentation d’une pièce, mais les « copier-coller » dans Blogger sont décidément trop capricieux et je n’ai pas le courage de reproduire les italiques et autres académismes requis. Traduction C.-A. F. aka Holly G.
*****
L'histoire se déroule dans un pays qui se veut imaginaire, même s'il a les traits de la Belgique et de la Hollande. Une jeune femme, Colette (Vanessa Paradis) est désespérée. Elle est en manque d'enfant. On l'imagine dans la trentaine, ce minuit de la féminité (le temps ne cesse de filer dans ce film ; la plupart des plans montrent une horloge ou un réveil, et Colette devient un double du Capitaine Crochet qui a peur de ce temps qui le grignote à chaque instant et va le révéler à la lumière de son échec), ce moment fatidique où le ventre réclame trop fort et s'impatiente dans l'attente d'une immense floraison - il y a un livre à faire sur le ventre des femmes, croyez-moi -, où la vieillesse cligne de l'oeil au reflet de la femme, si celle-ci est suffisamment mature (flétrie peut-être aussi... Il est remarquable à quel point Vanessa Paradis est fatiguée et vieillie dans ce film, elle qui était une nymphe autrefois. Bien sûr, elle est toujours sublime, à mes yeux en tout cas, mais elle semble porter ses enfants sur son visage tendu et prêt à pleurer...) pour avoir envie de tendre le relais à un enfant.
Je ne suis pas une amie des mères. J'ai de solides raisons. Je me méfie d'elles autant que je puis les aimer quelquefois, leur reconnaissant de temps en temps un rare mérite, qui est celui de l'inconditionné. Il est simplement dommage que la majorité d'entre elles confondent cet enfant intérieur dont je parle souvent, caché ou non, derrière l'ombre de Barrie, avec celui auquel elles donnent vie. L'erreur est là, très aisée à commettre, voire tentante. Je me demande souvent, en regardant Colette / Vanessa, si elle ne se trompe pas de cible et si elle n'embrasse pas son propre manque, le confondant avec l'amour d'un enfant rêvé, à la manière de Charles Lamb. Elle a peur que son tour ne soit bientôt passé, comme elle le dit joliment. On songe au manège des enfants et au ticket supplémentaire qui permet une dernière danse sur le dos d'un cheval en bois. On ne sait rien de cette femme, qui est déjà mère dans son âme et dans son désespoir, à qui il ne manque qu'un petit pour la combler. Du moins le croit-elle fermement, jusqu'à se rompre. Elle essaie, dans sa tendre folie, de trouver un homme, n'importe lequel, qui puisse lui faire un enfant, avant de retrouver celui qu'elle aime, afin qu'il prenne soin d'elle et lui donne une maison pour les jours de pluie. L'enfant serait un cadeau qu'il ne pourrait refuser. Cette naïveté charmante est coupable, mais on ne peut lui en vouloir, n'est-ce pas ?
On sait très bien, d'emblée, que son amoureux l'a laissé tomber. On se doute que tout est fichu et qu'elle n'est qu'une môme qui mime avec des jouets grandeur nature le rôle de la maman et de la putain.
Elle remplace une amie dans une vitrine et fait la pute, avec beaucoup d'innocence et de tendresse, lorsque le coup de fil d'une étrangère lui demande d'aller chercher son fils dans un institut pédo-psychiatrique et de l'attendre à la gare où un train devrait la conduire. L'enfant possède la clef d'une consigne, où toutes les économies que sa mère-pute a dérobées à son maquereau sont cachées. Elle raccroche brusquement et Colette, malgré elle, se rend à ce rendez-vous. Colette ne cesse de faire ce qu'elle prétend ne pas vouloir faire. Elle ne peut affirmer sa volonté que dans le refus de l'évidence. Elle dit "non" et cela signifie "oui". Les femmes sont des êtres compliqués. Elles ont une bombe dans le corps. Le compte à rebours débute à leur naissance.
Colette se rend quelque part. On dirait une prison. Est-elle une bonne fée ou bien Gretel ? C'est l'une des plus belles scènes de ce film, finalement plus étrange qu'il n'y paraît. On a le sentiment de se retrouver quelques instants chez Dickens, lorsque tous ses visages d'enfants mangent des yeux cette hypothétique mère qui vient chercher l'un d'entre eux. Cela me rappelle aussi certaine scène coupée de la pièce Peter Pan - pardon, je suis obsédée, mais je ne compte pas me soigner - où prend place une farandole de Beautiful Mothers qui viennent chercher un bambin, un des enfants perdus, et sont... auditionnées par Wendy !
Elle rencontre pour la première fois un jeune garçon, Billy (Vincent Rottiers). Il est plus âgé qu'on ne peut le penser tout d'abord. Mais il semble déficient, un peu simple d'esprit, mais il ne souffre pas de ce manque que seuls les autres lui imputent ; à moins qu'il n'ait compris ce que les gens intelligents ont tant de mal à saisir, car c'est un peu une fable que ce film, en plus d'être un conte.
Il sera son Hansel, très rapidement. Ils traverseront une forêt, symbolisée ici par une fuite et un voyage. L'un doit échapper à l'assassin de sa mère, l'autre veut rejoindre son pâle amoureux.
Vanessa Paradis est de ces femmes-enfants qui m'ont toujours fascinée et émue. J'ai déjà livré deux mots sur ces créatures presque mythologiques. Il y a du sang de sirène en elles, à condition de bien se souvenir de la triste et sublime fin de celle d'Andersen. Ce n'est peut-être pas un hasard si Serge Frydman a utilisé quelques chansons de Tom Waits (allez voir le billet de mon amie Fauna sur cet artiste singulier) pour ce premier film qu'il offre en tant que réalisateur (et scénariste et dialoguiste) et qui n'est autre qu'un conte sur l'enfance. Venant de moi, cela ne vous étonnera puisque l'enfance est le monde où je m'ébats. Tom Waits est le chanteur qui convenait car sa seule voix est déjà une histoire à elle seule. Elvis Presley donne aussi, grâce à sa voix divine, une idée d'un certain paradis, celui des rêves... Sans oublier la présence décalée de Thomas Fersen, en père gardien d'une voiture de pompier, dans un café... Cela lui va très bien.
J'en ai presque trop dit sur ce film qui n'attend que vous pour être adopté, tel un enfant.
Traduction C.-A. F. aka Holly G.- Mais, Peter, ne feras-tu jamais rien d'utile ?Et Peter de répondre :-Veux pas être utile ! Mais je serai de bonne compagnie pour les enfants morts. Avec ma gaieté, je viendrai chanter quand le glas sonnera ; ainsi ils n'auront pas peur. Je danserai auprès de leurs petites tombes. Ils m'applaudiront et crieront : "Encore ! Encore!", car ils savent que c'est drôle et parce que l'amusement est tout ce qu'ils aiment.
Quelques chapitres...
Les roses du Pays d'Hiver
Retrouvez une nouvelle floraison des Roses de décembre ici-même.
Rechercher sur mon JIACO
Qui suis-je ?

- Holly Golightly
- Never Never Never Land, au plus près du Paradis, with Cary Grant, France
- Dilettante. Pirate à seize heures, bien que n'ayant pas le pied marin. En devenir de qui j'ose être. Docteur en philosophie de la Sorbonne. Amie de James Matthew Barrie et de Cary Grant. Traducteur littéraire. Parfois dramaturge et biographe. Créature qui écrit sans cesse. Je suis ce que j'écris. Je ne serai jamais moins que ce que mes rêves osent dire.
Almanach barrien
En librairie
Où Peter Pan rencontre son double féminin...


Oeuvre de Céline Lavail


Lettres
Voyages
Écosse
Kirriemuir
Angleterre
Londres
Haworth
Allemagne
Venise
New York
Liens personnels
Le site de référence de J.M. Barrie par Andrew Birkin (anglais)
Mon site consacré à J.M. Barrie (français ; en évolution permanente)
Site de la Société des amis de J.M.Barrie (français ; en construction)
Liens affiliés à ce JIACO
Blog Archive
- 2020 (1)
- 2019 (1)
- 2018 (4)
- 2017 (8)
- 2016 (1)
- 2015 (22)
- 2014 (15)
- 2013 (22)
- 2012 (34)
- 2011 (20)
- 2010 (34)
- 2009 (66)
- 2008 (74)
- 2007 (143)
-
2006
(447)
- décembre(21)
- novembre(19)
- octobre(20)
- septembre(21)
- août(33)
- juillet(23)
- juin(43)
- mai(44)
- avril(62)
- mars(50)
- février(51)
-
janvier(60)
- janv. 31(3)
- janv. 30(3)
- janv. 27(1)
- janv. 26(1)
- janv. 25(4)
- janv. 24(3)
- janv. 23(3)
- janv. 22(1)
- janv. 20(2)
- janv. 19(3)
- janv. 18(2)
- janv. 17(1)
- janv. 16(2)
- janv. 15(1)
- janv. 13(5)
- janv. 12(2)
- janv. 11(2)
- janv. 10(3)
- janv. 09(1)
- janv. 08(1)
- janv. 07(2)
- janv. 05(4)
- janv. 04(2)
- janv. 03(2)
- janv. 02(2)
- janv. 01(4)
- 2005 (217)
Archives
-
►
2018
(4)
- ► juillet 2018 (1)
- ► avril 2018 (1)
- ► février 2018 (1)
-
►
2017
(8)
- ► juillet 2017 (6)
- ► avril 2017 (1)
-
►
2015
(22)
- ► décembre 2015 (3)
- ► octobre 2015 (1)
- ► avril 2015 (1)
-
►
2014
(15)
- ► juillet 2014 (3)
- ► janvier 2014 (1)
-
►
2013
(22)
- ► novembre 2013 (1)
-
►
2012
(34)
- ► novembre 2012 (1)
- ► juillet 2012 (12)
- ► avril 2012 (1)
-
►
2011
(20)
- ► décembre 2011 (1)
- ► octobre 2011 (1)
- ► septembre 2011 (1)
- ► janvier 2011 (1)
-
►
2010
(34)
- ► novembre 2010 (1)
-
►
2009
(66)
- ► juillet 2009 (11)
- ► avril 2009 (8)
-
►
2008
(74)
- ► novembre 2008 (1)
- ► septembre 2008 (4)
- ► juillet 2008 (17)
- ► avril 2008 (11)
-
►
2007
(143)
- ► décembre 2007 (8)
- ► novembre 2007 (6)
- ► juillet 2007 (14)
- ► avril 2007 (18)
- ► février 2007 (16)
-
►
2006
(447)
- ► décembre 2006 (21)
- ► novembre 2006 (19)
- ► octobre 2006 (20)
- ► septembre 2006 (21)
- ► juillet 2006 (23)
- ► avril 2006 (62)
- ► février 2006 (51)
- ► janvier 2006 (60)
-
►
2005
(217)
- ► décembre 2005 (62)
- ► novembre 2005 (98)
- ► octobre 2005 (49)