
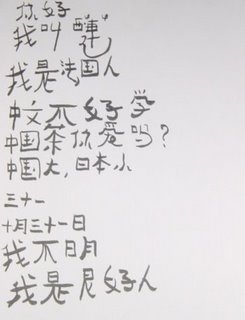

"Le doute me ronge. Et si tout n'était qu'illusion ? Si rien n'existait ? Dans ce cas, j'aurais payé ma moquette trop chère." (Dieu, Shakespeare et moi, opus I)







"Il est absurde de conclure que les idées manquent de sens et de lucidité parce qu'elles appartiennent à un ordre de sensations et de raisonnements qui est tout à fait inacessibles à notre éducation et à nos habitudes." La fée aux miettes





 ou sa feuille blanche. Derrière cette inertie apparente, cet échec couvé, jour après jour, contre lequel on lutte pour tirer de soi un misérable éclat et des tonnes de gangue inutile, on s'étiole, on se perd, on crève de désespoir chaque jour davantage. On est seuls. On l'est toujours mais, là, cette conscience vous éclate à la gueule comme jamais. Le pire, songez-y, est que l'on a dégoupillé de plein gré cette grenade.
ou sa feuille blanche. Derrière cette inertie apparente, cet échec couvé, jour après jour, contre lequel on lutte pour tirer de soi un misérable éclat et des tonnes de gangue inutile, on s'étiole, on se perd, on crève de désespoir chaque jour davantage. On est seuls. On l'est toujours mais, là, cette conscience vous éclate à la gueule comme jamais. Le pire, songez-y, est que l'on a dégoupillé de plein gré cette grenade.
"(...) Jenny Garp, qui aimait donner d'elle-même la définition que son père avait un jour donnée du romancier: "Un médecin qui ne s'occupe que des incurables."(Le Monde selon Garp)Dans le monde selon son père, comme le savait Jenny Garp, il faut avoir de l'énergie. Sa célèbre grand-mère, Jenny Fields, nous voyait naguère comme appartenant à diverses catégories, les Externes, les Organes vitaux, les Absents et les Foutus. Mais, dans le monde selon Garp, nous sommes tous des incurables."
"Quand il fit descendre la roue diamantée dans ses rainures, j’essayai de chasser son vrombissement de mon esprit. Avant d’éprouver quoi que ce soit, je vis le sang éclabousser les verres des lunettes protectrices, au travers desquelles les yeux d’Owen ne cillèrent pas, tant il était expert à manier son outil." (Une Prière pour Owen)
(Owen ampute son ami pour lui éviter le Vietnam)
Cette part d'homme arrachée pour les besoins de telle ou telle histoire est symbolique d'une béance dans l'existence de l'auteur. Les romanciers véritables sont tous des orphelins. De père, de mère, d'enfance, de vérité ou de mémoire. Il leur manque quelque chose qui leur a été volé ou que l'on a empêché de naître. Ecrire permet peut-être d'être indemnisé. Faire subir une mutilation à un personnage devient une façon de se reconstituer. Le raisonnement est peut-être pervers, cependant il me paraît juste lorsque l'on prend connaissance de l'oeuvre tout entière d'Irving et que l'on devine son passé.
"La vie, écrivit Garp, n'est pas tristement structurée comme un de ces bons vieux romans d'autrefois. Au contraire, le dénouement survient lorsque tous ceux qui étaient destinés à s'éteindre se sont éteints. Rien ne reste, sinon la mémoire. Mais même un nihiliste a une mémoire." (Le Monde selon Garp)
"Un épilogue, écrivit un jour Garp, est bien davantage qu'un simple bilan des pertes. Un épilogue, sous couvert de boucler le passé, est en réalité une façon de nous mettre en garde contre l'avenir."(Le Monde selon Garp)
"(...) Garp répondait que la base autobiographique - en admettant qu'elle existât - était, de tous les niveaux, le moins intéressant pour aborder la lecture d'un roman. Comme il l'affirmait toujours, l'art du romancier est la capacité d'imaginer de façon vraie - c'est, comme dans toute forme d'art, un processus de sélection. Les expériences et les souvenirs personnels - "les relents de tous les traumatismes de nos banales existences" - étaient, pour le romancier des modèles suspects, outenait Garp."Il faut que la fiction soit mieux faite que la vie", écrivit Garp. Et il vouait une haine obstinée à ce qu'il appelait le "kilométrage bidon des épreuves personnelles", et à ces écrivains dont les oeuvres n'étaient "importantes" que parce que quelque chose d'important s'était passé dans leurs vies. La pire des raisons pour incorporer quelque chose à une oeuvre, soutint-il un jour, est que la chose en question soit authentique, qu'elle soit réellement arrivée. "Tout est réellement arrivé, un jour ou l'autre! vitupérait-il. La seule raison pour incorporer une chose à un roman est que ce soit la chose qu'il aurait été idéal de voir arriver à ce moment-là." " (Le Monde selon Garp)
"Dans la plupart des livres, on sait tout de suite qu'y se passera rien, expliqua Jillsy. Seigneur ! vous le savez bien, non ? Dans d'autres livres, y se passe quelque chose et on sait tout de suite quoi, ce qui fait que c'est pas la peine de les lire. Mais ce livre, il est si tordu qu'on sait qu'y va s'y passer quelque chose, mais on arrive pas à imaginer quoi. Faudrait être tordu soi-même pour imaginer ce qui se passe dans ce livre." (Le Monde selon Garp)
"Garp regarda Helen ; il ne pouvait plus bouger que les yeux. Helen, il le voyait, tentait de lui rendre son sourire. Avec ses yeux, Garp essaya de la rassurer : Ne t'inquiète pas - quelle importance s'il n'y a pas de vie après la mort ? Il y a une vie après Garp, crois-moi. Même s'il n'y a que la mort après la mort, il faut avoir la reconnaissance des petits bienfaits - par exemple, parfois, une naissance après l'amour. Et, avec beaucoup de chance, parfois, l'amour après une naissance !" (Le Monde selon Garp)
("Quand meurt, de façon inattendue, une personne aimée, on ne la perd pas tout en bloc ; on la perd par petits morceaux, et ça peut durer très longtemps. Ses lettres qui n'arrivent plus, son parfum qui s'efface sur les oreillers et sur les vêtements. Progressivement, on additionne les pièces manquantes. Puis vient le jour où l'un de ces petits manques fait déborder la coupe du souvenir ; on comprend qu'on l'a perdue, pour toujours... Puis vient un autre jour, et une nouvelle petite pièce manquante." (Une Prière pour Owen)
(Une Prière pour Owen)
"C'est Owen Meany qui m'apprit que tout bon livre évolue continuellement, du général au particulier, du détail à l'ensemble, et ainsi de suite. Une bonne lecture et une bonne interprétation de lecture doivent évoluer de façon identique. Prenant pour exemple Tess d'Urberville, il m'apprit à rédiger un exposé en reliant les incidents qui déterminent le destin de l'héroïne à l'étonnante phrase qui conclut le chapitre XXXVI : "De nouvelles végétations bourgeonnent insensiblement pour remplir les vides : des accidents imprévus contrarient les intentions, et tous les vieux projets sont oubliés. "Ce fut une révélation pour moi : en réussissant mon premier compte rendu de lecture, j'avais enfin appris à lire. Plus pragmatiquement, Owen améliora ma lecture par des moyens techniques ; il avait découvert que mes yeux ne pouvaient se poser sur une seule ligne à la fois, ce qui m'obligeait à suivre avec mon doigt ; il imagina de me faire lire à travers une feuille percée d'un trou, comme une petite fenêtre ne découvrant que deux ou trois lignes."
"- LIRE, C'EST UN DON.- C'est toi qui m'as appris.- PEU IMPORTE. C'EST UN DON, ET SI TU AIMES QUELQUE CHOSE, IL FAUT LE PRÉSERVER - SI TU AS LA CHANCE DE TROUVER LE MODE DE VIE QUE TU AIMES, TU DOIS TROUVER LE COURAGE DE LE VIVRE."
« - Papa, répéta-t-elle, j’ai fait un rêve, j’ai entendu un bruit.
- Un bruit comment, Ruthie ?
Son père n’avait pas bougé, mais il était réveillé.
- Il est entré dans la maison.
- Qui ça ? Le bruit ?
- Il est dans la maison, mais il essaie de ne pas faire de bruit.
- Alors on va aller le chercher. Un bruit qui essaie de ne pas fairede bruit, il faut que je voie ça, moi. »
(Une Veuve de papier)
Ce roman-ci était déjà un roman archéologique, comme tous les livres d'Irving. Et je crois qu'il est, avec L'oeuvre de Dieu, la part du diable, celui qui permet de mieux comprendre Je te retrouverai. Tous ses romans parlent du souvenir et de la mémoire, que ce soit flagrant ou discret, mais ce roman-ci est ouvertement un livre qui raconte le vol d'une enfance et la manipulation de la mémoire par une mère à l'encontre de son fils.
Qu'est-ce qu'un romancier sinon un dieu qui possède la mémoire de son univers et de ses personnages ? Qu'est-ce qu'un romancier sinon quelqu'un qui est attentif à la perte de l'invisible et qui le traque inlassablement ?
"Il sentit quelque chose lui échapper. S'il avait essayé de décrire le phénomène au Fantôme gris, elle lui aurait sans doute dit qu'il avait perdu son âme. Quelque chose d'essentiel venait de disparaître, dont la fuite passait presque inaperçue, comme celle de l'enfance." (Je te retrouverai)
[Toutes les traductions citées sont celles publiées par les éditions du Seuil.]
*******************
John Irving parle de son dernier roman, et du tatouage qui l'a inspiré :
Quelques mots sur son artisanat (il explique qu'il se perçoit comme un artisan et non comme un artiste ; ce qui importe à ses yeux est la démonstration d'une vérité psychologique et émotionnelle, par le fait d'une histoire palpitante, non pas un travail intellectuel) :
Quelques chapitres...
Les roses du Pays d'Hiver
Retrouvez une nouvelle floraison des Roses de décembre ici-même.
Rechercher sur mon JIACO
Qui suis-je ?

- Holly Golightly
- Never Never Never Land, au plus près du Paradis, with Cary Grant, France
- Dilettante. Pirate à seize heures, bien que n'ayant pas le pied marin. En devenir de qui j'ose être. Docteur en philosophie de la Sorbonne. Amie de James Matthew Barrie et de Cary Grant. Traducteur littéraire. Parfois dramaturge et biographe. Créature qui écrit sans cesse. Je suis ce que j'écris. Je ne serai jamais moins que ce que mes rêves osent dire.
Almanach barrien
En librairie
Où Peter Pan rencontre son double féminin...


Oeuvre de Céline Lavail


Lettres
Voyages
Écosse
Kirriemuir
Angleterre
Londres
Haworth
Allemagne
Venise
New York
Liens personnels
Le site de référence de J.M. Barrie par Andrew Birkin (anglais)
Mon site consacré à J.M. Barrie (français ; en évolution permanente)
Site de la Société des amis de J.M.Barrie (français ; en construction)
Liens affiliés à ce JIACO
Blog Archive
- 2020 (1)
- 2019 (1)
- 2018 (4)
- 2017 (8)
- 2016 (1)
- 2015 (22)
- 2014 (15)
- 2013 (22)
- 2012 (34)
- 2011 (20)
- 2010 (34)
- 2009 (66)
- 2008 (74)
- 2007 (143)
-
2006
(447)
- décembre(21)
- novembre(19)
- octobre(20)
- septembre(21)
- août(33)
- juillet(23)
- juin(43)
- mai(44)
- avril(62)
- mars(50)
- février(51)
-
janvier(60)
- janv. 31(3)
- janv. 30(3)
- janv. 27(1)
- janv. 26(1)
- janv. 25(4)
- janv. 24(3)
- janv. 23(3)
- janv. 22(1)
- janv. 20(2)
- janv. 19(3)
- janv. 18(2)
- janv. 17(1)
- janv. 16(2)
- janv. 15(1)
- janv. 13(5)
- janv. 12(2)
- janv. 11(2)
- janv. 10(3)
- janv. 09(1)
- janv. 08(1)
- janv. 07(2)
- janv. 05(4)
- janv. 04(2)
- janv. 03(2)
- janv. 02(2)
- janv. 01(4)
- 2005 (217)
Archives
-
►
2018
(4)
- ► juillet 2018 (1)
- ► avril 2018 (1)
- ► février 2018 (1)
-
►
2017
(8)
- ► juillet 2017 (6)
- ► avril 2017 (1)
-
►
2015
(22)
- ► décembre 2015 (3)
- ► octobre 2015 (1)
- ► avril 2015 (1)
-
►
2014
(15)
- ► juillet 2014 (3)
- ► janvier 2014 (1)
-
►
2013
(22)
- ► novembre 2013 (1)
-
►
2012
(34)
- ► novembre 2012 (1)
- ► juillet 2012 (12)
- ► avril 2012 (1)
-
►
2011
(20)
- ► décembre 2011 (1)
- ► octobre 2011 (1)
- ► septembre 2011 (1)
- ► janvier 2011 (1)
-
►
2010
(34)
- ► novembre 2010 (1)
-
►
2009
(66)
- ► juillet 2009 (11)
- ► avril 2009 (8)
-
►
2008
(74)
- ► novembre 2008 (1)
- ► septembre 2008 (4)
- ► juillet 2008 (17)
- ► avril 2008 (11)
-
►
2007
(143)
- ► décembre 2007 (8)
- ► novembre 2007 (6)
- ► juillet 2007 (14)
- ► avril 2007 (18)
- ► février 2007 (16)
-
▼
2006
(447)
- ► décembre 2006 (21)
- ► novembre 2006 (19)
- ▼ octobre 2006 (20)
- ► septembre 2006 (21)
- ► juillet 2006 (23)
- ► avril 2006 (62)
- ► février 2006 (51)
- ► janvier 2006 (60)
-
►
2005
(217)
- ► décembre 2005 (62)
- ► novembre 2005 (98)
- ► octobre 2005 (49)





